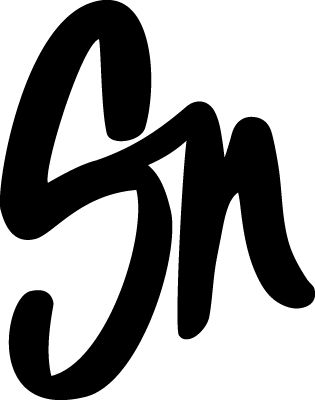Chaque année, le crédit impôt innovation (CII) bénéficie à des milliers de PME. Parmi elles, les entreprises du numérique représentent une part importante, notamment les éditeurs de logiciels. Le CII leur permet de valoriser les dépenses liées à la conception de produits innovants, comme une première version ou une version améliorée d’un logiciel destiné au marché. Pour aller plus loin sur les usages logiciels dans les entreprises, vous pouvez consulter notre article sur les logiciels RH et leur rôle dans les entreprises innovantes.
Mais qu’en est-il des travaux de mise à jour ou d’amélioration continue réalisés entre deux versions ? Peut-on les considérer comme des activités éligibles au CII ? La question a longtemps divisé, jusqu’à une jurisprudence rendue en avril 2025.
Ce que couvre le crédit impôt innovation
Le crédit impôt innovation a été instauré en 2013 pour soutenir les démarches d’innovation des PME. Depuis le 1er janvier 2025, il permet de récupérer 20 % des dépenses éligibles, dans la limite de 80 000 euros par an.
Pour entrer dans le champ du CII, les travaux doivent viser la conception ou l’amélioration d’un produit nouveau, matériel ou immatériel, destiné à la commercialisation. L’innovation peut porter sur des fonctionnalités, la performance technique, l’ergonomie ou l’éco-conception. En revanche, un produit destiné à un usage interne ou des travaux de maintenance technique sans apport nouveau ne sont pas éligibles.
L’amélioration continue en question
Dans les entreprises du logiciel, les équipes techniques travaillent souvent en mode agile. Cela implique un cycle de développement itératif, avec des mises à jour régulières : corrections de bugs, améliorations UX/UI, refactoring du code, montée de version des dépendances, ajouts fonctionnels. Ces activités s’inscrivent dans ce qu’on appelle le « versioning » ou amélioration continue.
Elles sont pourtant au cœur du doute : s’agit-il d’une simple maintenance corrective ou évolutive ? Ou bien d’une innovation justifiant une aide publique ? Une décision rendue par la cour administrative d’appel de Toulouse en avril 2025 a permis d’apporter un élément de réponse clair. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir la question de l’éligibilité au CII, la jurisprudence est accessible en intégralité sur Légifrance.
La jurisprudence Equadex : un tournant
La société Equadex, éditeur d’un logiciel commercialisé dès janvier 2013, a continué à développer son produit pendant les deux années suivantes. Ces travaux, d’après l’entreprise, ont conduit à des versions enrichies, même s’ils n’ont pas donné lieu à un lancement officiel de « nouvelle version ». Elle a donc déclaré les dépenses correspondantes au titre du CII.
L’administration fiscale, lors d’un contrôle, a estimé que ces travaux ne relèvent que de simples mises à jour demandées par des clients et a rejeté leur éligibilité. S’en est suivi un redressement. D’abord déboutée par le tribunal administratif de Nîmes, Equadex a saisi la cour administrative d’appel de Toulouse qui, le 10 avril 2025, a annulé le redressement.
La cour a considéré que les travaux d’amélioration réalisés en 2013 et 2014 ne se limitaient pas à des corrections techniques. Ils ont apporté des fonctionnalités nouvelles (modules de saisie de contrats, transmission de chiffrages), amélioré l’ergonomie, enrichi le produit. Elle a donc jugé que cela constituait bien un produit nouveau au sens du CII.
Même si certaines améliorations émanaient de demandes client et ont été facturées, la cour a estimé que cela ne remettait pas en cause l’innovation, tant que ces fonctionnalités ne sont pas présentes sur d’autres produits du marché.
Les critères d’éligibilité à retenir
La jurisprudence Equadex donne des repères utiles aux éditeurs de logiciels. Pour que les travaux d’amélioration continue soient acceptés au titre du CII, il faut pouvoir démontrer :
- Que ces travaux apportent une différenciation fonctionnelle, technique ou ergonomique significative.
- Que le résultat obtenu présente des fonctionnalités ou performances nouvelles non disponibles sur le marché.
- Que ces évolutions vont au-delà de la maintenance standard (corrections, mises à jour mineures).
Le fait qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle version officielle ou que les travaux aient répondu à des besoins clients n’est pas un obstacle, dès lors qu’il existe un apport innovant objectivable.
Bonnes pratiques pour documenter l’innovation
La clé pour sécuriser un dossier CII reste la preuve. Les entreprises doivent être en mesure de démontrer l’existence de ces apports nouveaux, et de les distinguer clairement de la maintenance courante.
Voici quelques pratiques recommandées :
- Documenter les étapes techniques (maquettes, wireframes, tickets de développement).
- Dater les évolutions et les référencer dans un historique de version.
- Produire des comparatifs avant/après ou des benchmarks concurrentiels.
- Conserver les échanges internes et spécifications fonctionnelles.
Une approche structurée permet de construire un argumentaire solide et, en cas de contrôle, de justifier l’éligibilité des travaux sans ambiguité.
Un levier financier pour les éditeurs de logiciel
L’ouverture du CII à certains travaux d’amélioration continue change la donne pour les éditeurs de logiciels. Cela signifie que chaque cycle de développement, même entre deux versions majeures, peut représenter une opportunité de financement.
Dans un contexte où la pression concurrentielle impose des mises à jour fréquentes, cette reconnaissance permet d’intégrer la dimension fiscale au cœur de la stratégie produit. Encore faut-il adopter les bons réflexes en amont.
Cette évolution s’inscrit plus largement dans un cadre où l’innovation numérique occupe une place centrale dans l’économie. Pour mieux comprendre ce contexte, vous pouvez également lire notre article L’économie française en 2025 : croissance modérée et défis à surmonter.
Conclusion
Peut-on obtenir du CII pour l’amélioration continue d’un logiciel ? Oui, dès lors que les travaux vont au-delà de la simple maintenance et qu’ils apportent une valeur fonctionnelle ou ergonomique significative, différenciante, et orientée vers le marché.
La jurisprudence d’avril 2025 clarifie les conditions, tout en rappelant l’importance d’un dossier technique solide. Pour les startups du numérique, cette reconnaissance offre une voie supplémentaire pour valoriser l’effort d’innovation au quotidien, et renforcer leur trésorerie sans renoncer à leur dynamique produit.